|
La
tonalité, le mode, l'armature
 |
La tonalité
: C'est donc à la lecture d'une partition ou l'on va determiner comment lire les notes contenues dans les mesures et aussi determiner dans quelle tonalité est le morceau (voir ci dessous) En
théorie 15 gammes, en pratique 12 gammes (correspondant
aux 12 demi tons) Contrairement aux musiques tonales que nous venons de décrires, sont modales les autres musiques y compris les modes majeurs ou mineurs.
Voici un excellent site pour voir et entendre toutes les gammes |
Les
modes que nous allons examiner permettent d'expérimenter diverses
combinaisons de tons et demi-tons et de colorer ainsi la musique de nos
modes occidentaux majeurs et mineurs avec des notes altérées
de façon systématique.
Il existe de nombreux modes musicaux et presque autant de définitions.
Pour rester simple, nous distinguerons:
- les modes harmoniques naturels et leurs dérivés du mineur
mélodique ascendant,
- les modes ethniques, pour ne pas dire exotiques.
En Europe, la musique
du moyen-âge et de la Renaissance était fondée sur
l'utilisation de ces modes.
La
musique modale fut ensuite abandonnée pendant plusieurs siècles,
laissant la place à la musique tonale
construite uniquement sur deux de ces modes : majeur
et mineur.
Les Modes naturels
sont construits à partir de chaque note
de la gamme majeure naturelle.
Encore appelés modes grecs, ou ecclésiastiques
(puis grégoriens à la fin du XIX e siècle), ils sont
dénommés : mode de DO, de RE, etc., ou encore mode ionien,
dorien, phrygien, (voir schéma ci-contre).
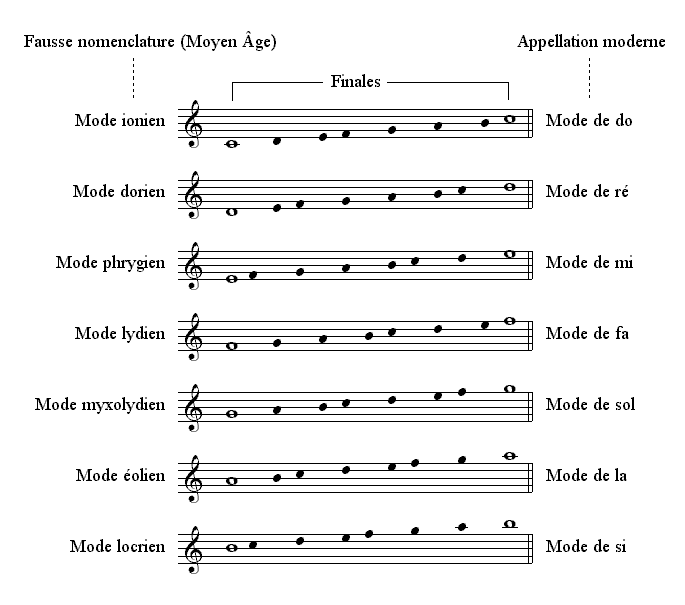
Chaque
mode a une sonorité qui lui est propre, un caractère, du
par sa tonique et par les intervalles qui la séparent des autres
notes.
Le mode de DO est
: Gai et guerrier, Obscur et triste
Le mode de RE est Joyeux et très guerrier, Grave et dévot
Le mode de MIb est Cruel et dur Horrible, affreux
Le mode de MI est Querelleur et criard, Efféminé, amoureux
et plaintif
Le mode de FA est Furieux et emporté, Obscur et plaintif
Le mode de SOL est Doucement joyeux, Sérieux et magnifique
Le mode de LA est Joyeux et champêtre, Tendre et plaintif
Le mode de SIb est Magnifique et joyeux, Obscur et terrible
le mode de SI est Dur et plaintif, Solitaire et mélancolique
Sur ce tableau, le mode de Do ou Ionien correspond au mode Majeur, le
mode le La ou Eolien correspond au mode mineur.
À la
fin du XIXe siècle, cette pratique est agrémentée
d'autres modes, créés ou inspirés des musiques traditionnelles
extra-européennes.
Restons en la, c'est déjà pas mal de choses à assimiler.
En fait "les modes" sont
un plus vaste domaine, voir
le site
Trouver la tonalité d'un
morceau (assez simple) grâce au solfège :
Nous venons de le voir Il y a 3 types d’armures
(ou armatures) :
Selon l'armature dans le tableau (ci dessus) on retrouve les deux tonalités
éligibles de caractère majeur ou mineur

Lorsqu'on ne connait pas le tableau par coeur on a recours à l'ordre
des dièses et des bémols
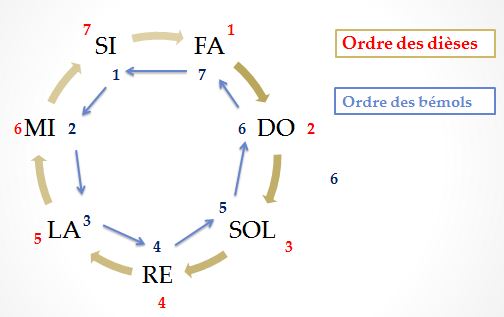 à apprendre par coeur
à apprendre par coeur
Si
l'armature est avec :
Dièse(s): Prendre
le dernier dièse et ajouter 1/2 ton (ex:
2# = fa#do# alors on est en Ré maj ou Sim)
Bémol(s): Prendre l’avant
dernier bémol (ex: 3b = sib mib lab alors on est en Mib maj
ou Dom)
Vierge: On est en Do Majeur ou La
mineur
Et maintenant trancher entre tonalité majeure et mineure, pour
cela regardez la première et la dernière note du morceau.
Très souvent la dernière note est la fondamentale . Ex pas
d'altération on doit choisir majeur ou mineur, si la dernière
note est do on est en Do majeur, si la dernière note est la on
est en La mineur.
(Mais attention à l'intérieur d'un morceau ou d'une mélodie
on peut passer de majeur et mineur ou l'inverse durant quelques notes
ou mesures, il faudra décoder quant on en saura plus sur l'harmonisation).
Trouver
la tonalité d’un morceau par analyse
Cependant, cette technique n’est pas infaillible,
et il parfois mieux de se référer à l’analyse
des accords pour trouver la tonalité du morceau.
1) Chercher l’accord diminué
Si on prend une gamme pour l’harmoniser (c’est
à dire construire des accords à partir de cette gamme),
puis que par la suite on analyse la nature des accords obtenus, on se
rend compte que quelle que soit la gamme choisis, la nature des accords
ne changera pas.
Exemple : On prend la gamme de Do Majeur
et on construit des accords à partir de cette gamme.
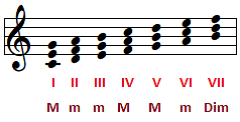
On analyse ensuite la nature
des accords obtenus : Le premier accord se trouve être un accord
majeur, le deuxième accord, un accord mineur… Et bien figurez-vous
que cette structure ne changera jamais et ce, quel que soit le nom de
gamme choisit. C’est-à-dire que même si vous prenez
une gamme de Fa# Majeur, le 6ème degré
de cette gamme sera un accord mineur et le
degré VII sera un accord diminué.
Faire ce même travail avec la gamme de Do mineur, le
2 ième degré de cette gamme sera un accord diminué
et ...
Schéma bilan :
Nature des accords d’une gamme majeure : ![]()
Nature des accords d’une gamme mineure : ![]()
Maintenant que vous savez que cette structure est fixe, vous vous
rendez compte qu’il n’y a qu’un seul
accord diminué par gamme. Retrouver
l’accord diminué d’un morceau, c’est donc retrouver
à coup sur la gamme dont il provient et donc par déduction
sa tonalité.
Vous savez donc que si vous repérez
un accord diminué dans un morceau, cet accord sera soit
l’accord du deuxième degré d’une gamme mineure,
soit l’accord du septième degré d’une gamme majeure.
Pour pouvoir trancher entre les deux tonalités, il vous suffit
tout comme je vous l’ai expliqué dans mon point précédend’analyser
le premier et le dernier accord du morceau.
2) Relever et analyser
les accords
Maintenant, si aucune des techniques précédentes
ne vous a permis de déterminer la tonalité du morceau, il
ne vous reste plus qu’à analyser les accords de ce morceau.
Pour ce faire, relevez chaque accord que vous trouverez puis demandez-vous
simplement de quelle gamme peuvent-ils provenir. C’est en fait le
strict inverse de ce qu’on a fait précédemment : au
lieu de construire les accords à partir de la gamme et de la tonalité,
on va définir la tonalité à partir des accords.
Il ne vous reste donc plus qu’à relever tous les accords du morceau, de les classer à la suite, puis de retrouver leur gamme d’origine (et donc leur tonalité) grâce à l’aide du tableau récapitulatif ci-dessus. En effet, si vous remarquez par exemple des accords avec uniquement les Fa et les Do qui sont dièses, alors cela signifie que l’on a 2# à la clé et que l’on est soit en Ré Majeur, soit en Si Mineur. Un coup d’œil aux accords et à la partition vous permettra ainsi de trancher définitivement pour la bonne tonalité.